Prévenir la désinsertion professionnelle : un enjeu majeur pour les organisations et les salariés
- Fanny LE GUEN
- 4 juin
- 8 min de lecture
Dernière mise à jour : 11 août

Le monde du travail évolue, et avec lui, de nouveaux défis émergent pour la santé et le maintien en emploi des salariés. Face au vieillissement de la population active, à l'allongement des carrières et à l'augmentation des maladies chroniques, la prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) est devenue un enjeu capital.
Qu'est-ce que la désinsertion professionnelle ?

La désinsertion professionnelle désigne le processus par lequel un salarié, potentiellement vulnérable en raison de son état de santé, rencontre des difficultés à maintenir son activité professionnelle, risquant à terme d'être exclu du marché du travail. Ces situations de vulnérabilité peuvent être d'origine professionnelle ou non, et ne sont pas nécessairement liées à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
🎯 L'objectif principal de la prévention de la désinsertion professionnelle est de repérer ce risque le plus en amont possible et de mettre en place des dispositifs permettant de maintenir le travailleur en emploi ou de favoriser son retour. Elle vise à limiter les conséquences de l'usure professionnelle, qui peuvent se traduire par de l'absentéisme, du turn-over, des accidents, des troubles musculo-squelettiques, ou des restrictions allant jusqu'à des déclarations d'inaptitude.
Pourquoi est-ce un enjeu majeur ?
Plusieurs facteurs expliquent la pertinence croissante de la prévention de la désinsertion professionnelle :
📌Augmentation des salariés à la santé altérée : En 2018, 22% de la population était touchée par une maladie chronique évolutive, et 36% déclaraient un problème de santé chronique ou durable. Près de 6 millions de personnes en âge de travailler se déclaraient en situation de handicap.
📌Conséquences pour les entreprises : Le non-respect des obligations légales concernant l'emploi des travailleurs handicapés, les déclarations d'inaptitude, et l'exclusion progressive des personnes fragilisées par la santé restent des tendances fortes, souvent synonymes de licenciements.
📌Bénéfices mutuels : Le maintien en activité peut contribuer à améliorer l'estime de soi du salarié et renforcer son identité socioprofessionnelle. Pour l'organisation, la prévention de la désinsertion professionnelle est un levier d'amélioration des conditions de travail, de motivation et d'inclusion des travailleurs, contribuant à la performance globale.
La loi du 2 août 2021 a renforcé les mesures en matière de prévention et de santé au travail, instaurant ou modifiant plusieurs dispositifs pour favoriser le maintien en emploi.
Les acteurs clés et l'importance de la coopération
🔑La réussite des politiques de prévention de la désinsertion professionnelle repose sur une coopération et des échanges améliorés entre tous les acteurs concernés. Cette pluralité d'acteurs (employeurs, salariés, services de prévention et de santé au travail (SPST), Assurance maladie, médecins traitants, organismes spécialisés comme Cap emploi) peut parfois générer des cloisonnements.
💡Pour surmonter ces difficultés, il est recommandé de :
🔖Outiller les acteurs sur "qui fait quoi" et comment développer une approche globale du maintien en emploi.
🔖Mettre en place des coopérations autour de projets ciblés, favorisant les échanges entre les partenaires internes et externes à l'organisation.
Les cellules pluridisciplinaires de prévention de la désinsertion professionnelle au sein des services de prévention et de santé au travail (SPST) interentreprises sont devenues obligatoires et ont pour vocation d'apporter des solutions personnalisées, formalisées dans un plan de retour à l'emploi.
Les dispositifs phares de la prévention de la désinsertion professionnelle
💡Plusieurs outils peuvent être mobilisés pour prévenir et accompagner la désinsertion professionnelle.
🔖Le rendez-vous de liaison
Objectif : Maintenir le lien entre le salarié en arrêt de travail (plus de 30 jours, continus ou discontinus) et l'employeur, et informer le salarié des actions de PDP disponibles. Ce n'est pas un rendez-vous médical.
Initiative : Il peut être organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. L'employeur doit informer le salarié de son existence.
Participants : Le SPST est associé et peut être représenté par un membre de l'équipe pluridisciplinaire ou de la cellule PDP. Le référent handicap de l'entreprise peut également participer avec l'accord du salarié.
Caractère : Il est facultatif ; le salarié peut refuser d'y participer sans aucune conséquence.
🔖La visite de pré-reprise
Objectif : Repérer les salariés à risque de désinsertion professionnelle et préparer leur retour au travail, en proposant des aménagements, un essai encadré, une CRPE ou des formations.
Quand : Pendant l'arrêt de travail, dès que l'état de santé le permet.
Initiative : Elle peut être demandée par le médecin du travail, le médecin traitant, le médecin conseil de l'Assurance maladie ou le salarié lui-même. L'employeur informe le salarié de cette possibilité, par exemple lors du rendez-vous de liaison.
Caractère : Facultative, mais fortement encouragée pour anticiper le retour au travail.
🔖La visite de reprise
Objectif : Vérifier la compatibilité du poste de travail avec l'état de santé du travailleur, examiner les propositions d'aménagement ou de reclassement et, si nécessaire, émettre un avis d'inaptitude.
Pour qui : Salariés revenant de congé maternité, d'absence pour maladie professionnelle, d'absence d'au moins 30 jours pour accident professionnel, ou d'un arrêt maladie d'au moins 60 jours.
Quand : Organisée par l'employeur le jour de la reprise effective du travail ou au plus tard dans les 8 jours qui suivent.
Caractère : Obligatoire pour les salariés concernés.
🔖La visite de mi-carrière
Objectif : Établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié, évaluer les risques de désinsertion professionnelle et sensibiliser aux enjeux du vieillissement au travail.
Pour qui : Salariés âgés de 45 ans, ou d'un âge déterminé par accord de branche.
Quand : Durant l'année du 45ème anniversaire du salarié, ou deux ans avant cet âge, ou l'âge fixé par accord de branche.
Par qui : Réalisée par un médecin du travail, un infirmier en pratique avancée ou un infirmier en santé au travail.
Contenu : Visite médicale pouvant se faire en téléconsultation, donnant lieu à une attestation. Le médecin peut proposer des mesures d'aménagement du poste ou du temps de travail.
🔖La Convention de Rééducation Professionnelle en Entreprise (CRPE)
Objectif : Permettre aux salariés pour qui une reprise de leur emploi est incertaine d'apprendre un nouveau métier, soit dans leur entreprise d'origine, soit dans une nouvelle entreprise. C'est une formation pratique et tutorée, complétée si besoin par de la formation professionnelle.
Bénéficiaires : Salariés inaptes ou à risque d'inaptitude identifié lors de la visite de préreprise, qu'ils bénéficient ou non de la RQTH.
Mise en place : Formalisée par une convention entre le salarié, l'employeur et la caisse d'assurance maladie, ainsi qu'un avenant au contrat de travail. Elle est préparée avant la fin de l'arrêt de travail.
Durée : Maximale de 18 mois, avec des règles spécifiques selon l'origine de l'arrêt (maladie ou AT/MP). Il n'y a pas de durée minimale.
Rémunération : Le salarié est rémunéré pendant la CRPE, avec un partage de la prise en charge entre l'Assurance maladie (indemnités journalières) et l'employeur (complément pour atteindre l'ancienne rémunération).
Accompagnement : Le salarié et l'employeur peuvent être accompagnés par le service social de l'assurance maladie, les SPST, et les organismes spécialisés comme Cap emploi.
Cumul : La CRPE peut être cumulée avec les aides de l'AGEFIPH.
🔖L'essai encadré
Objectif : Permet à un salarié en arrêt de travail de tester la compatibilité d'un poste de travail avec ses capacités restantes, que ce soit dans l'entreprise d'origine ou une autre entreprise. Il vise à tester l'ancien poste, un poste aménagé, un nouveau poste, ou à rechercher des pistes pour un reclassement.
Bénéficiaires : Salariés en arrêt de travail (y compris apprentis, intérimaires, stagiaires), y compris ceux en temps partiel thérapeutique.
Initiative : À l'initiative du salarié, mais peut être proposé par les SPST, le service social de l'Assurance maladie ou des organismes spécialisés.
Durée : Maximale de 14 jours ouvrables, renouvelable une fois pour une durée totale de 28 jours. Plusieurs essais sont possibles.
Statut : Le salarié est en arrêt de travail et son contrat est suspendu, continuant de percevoir des indemnités journalières.
Tuteur : Un tuteur au sein de l'entreprise d'accueil accompagne le salarié et rédige un bilan à l'issue de l'essai.
Assurance : Tout accident du travail pendant l'essai est pris en charge par la CPAM/CGSS.
Cumul : Peut être cumulé avec les aides de l'AGEFIPH ou OETH.
🔖Le Projet de Transition Professionnelle (PTP)
Objectif : Permet au salarié de mobiliser son Compte Personnel de Formation (CPF) pour financer une formation certifiante et changer de métier ou de profession.
Conditions : Généralement, une activité d'au moins deux ans, mais des dérogations existent pour les salariés en arrêt de travail prolongé ou reconnus handicapés.
Pendant le PTP : Le contrat de travail est suspendu, la rémunération est maintenue sous certaines conditions.
Prise en charge : Les Commissions Paritaires Interprofessionnelles Régionales (Transitions Pro) instruisent les dossiers et prennent en charge les coûts pédagogiques et la rémunération.
Vers une approche collective et organisationnelle

Historiquement, la prévention de la désinsertion professionnelle a souvent été abordée sous l'angle individuel des problèmes de santé. Cependant, il est crucial de passer d'une approche par le prisme "santé" individuelle à une approche "travail" plus globale et collective.
💡Cela implique de considérer le travail comme un facteur de construction ou de détérioration de la santé.
L'approche organisationnelle suppose d'agir sur :
Les situations de travail et les collectifs de travail.
Le management, en formant et sensibilisant les managers et élus du personnel.
La reconnaissance que la vulnérabilité est humaine, permettant aux collaborateurs d'adapter leurs façons de travailler.
La Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) comme levier global, faisant le lien entre conditions de travail, d'emploi, dialogue social et parcours professionnels. Une amélioration pour un individu en fragilité peut être bénéfique pour tous.
Il est essentiel de lutter contre l'exclusion et de concevoir des situations de travail soutenables par tous et dans la durée. Cela passe par une réflexion globale sur l'organisation du travail et une réduction ou allègement des contraintes, tout en augmentant les ressources pour y faire face.
Conclusion
📝 La prévention de la désinsertion professionnelle est un chantier continu qui nécessite une mobilisation collective.
En adoptant une approche proactive, en renforçant la coopération entre les multiples acteurs et en intégrant la qualité du travail au cœur des préoccupations, les organisations peuvent non seulement répondre à leurs obligations légales, mais aussi construire un environnement de travail plus inclusif, robuste et humain.
Il s'agit de mettre en place les conditions pour que le travail reste un vecteur important de construction de la santé pour tous, tout au long de la carrière.
RESSOURCES

EN SAVOIR PLUS SUR RH IN SITU
J’ai créé RH IN SITU en 2017 afin d’accompagner sous différents formats (temps partagé, projets ponctuels, formation, facilitation) les Petites et Moyennes Organisations sur toutes leurs problématiques liées au travail. Je réalise ainsi des interventions visant à :
🎯accompagner les réflexions sur les questions de gouvernance et d'organisations du travail
🎯développer les compétences de collectifs de managers sur des thématiques spécifiques (pratiques managériales, RH, droit du travail, santé, ...) ou via du codéveloppement professionnel et managérial
🎯structurer, fiabiliser, optimiser et sécuriser les pratiques RH (compétences, process, outils, digitalisation, ...)
🎯favoriser la santé au travail en combinant l'approche par les risques professionnels et l'approche clinique afin d'identifier et de développer les ressources psychosociales des collectifs
🎯améliorer la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT)
🎯accompagner les démarches de prévention en tant qu'Intervenante en Prévention des Risques Professionnelles (IPRP)
🎯accompagner les collectifs sur les questions de dialogue social et dialogue professionnel
🎯développer les compétences des représentants du personnel
🎯trouver les profils en adéquation avec les besoins des structures (sourcing, chasse, recrutement, ....)
🎯accompagner les transitions professionnelles
. . .
Plusieurs valeurs guident ma pratique professionnelle :
🤝Construire des relations authentiques, basées sur la confiance et la transparence
🤝Transmettre mes compétences aux équipes accompagnées pour développer leur autonomie
🤝Promouvoir un équilibre dans les relations employeur/salariés et un dialogue social et professionnel de qualité
🤝Avoir un impact positif sur la santé au travail des dirigeants, managers, salariés, …
🤝Contribuer, au travers de mes interventions, à la performance économique ET sociale des structures accompagnées













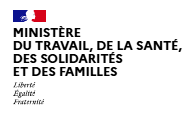






Commentaires